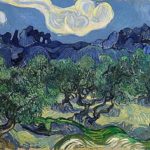Dans les liturgies chrétiennes anciennes des rit(e)s romains comme monastiques, on chante longuement durant la nuit. Les moines se lèvent à minuit encore parfois ou plus généralement maintenant à l’aurore, pour leur office nocturne. Il s’agit ici du plain chant grégorien et des vigiles, car chez les chrétiens comme dans d’autres religions, le jour fêté commence au coucher du soleil jusqu’à celui du lendemain. Vigile car il s’agit de veiller et de se tenir prêt. L’office reporté à l’aurore s’appellera Matines
Chaque office nocturne peut durer jusqu’à 2 heures, il se déroule en 3 parties, lesquelles comprennent principalement 3 à 5 psaumes, des lectures (leçons) et de grands chants ornés qui concluent chaque partie. Ces chants conclusifs sont devenus célèbres, monodiques à l’origine, mis progressivement en musique polyphonique à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui encore.
Pour les très grandes fêtes (doubles de 1ère classe selon l’ancienne appellation), s’il n’y a pas de fête équivalente qui suit, on chante les II è Vigiles ou Matines à la fin de la journée concernée, souvent avec des textes et de la musique différente ! Il faut garder en mémoire qu’un moine bénédictin par exemple prie et chante 8 heures par jour, tous les jours, durant toute sa vie de moine, qui peut durer plus de 60 ans… Il faut donc lui fournir un répertoire copieux !! La personne extérieure constate donc la complexité impressionnante du Paroissien romain et de l’Antiphonaire monastique, manuels du seul chant grégorien occidental.
Voir mes commentaires autour de la partition du Ludus Danielis /Jeu de Daniel, pages 60 et 71.. Ils concernent l’ajout de jeux liturgiques dans l’église, à la fin du 3 è Nocturne, comme celui des Trois Maries pour la Vigile pascale.
https://curti-curiosites.ch/wp-content/uploads/Jeu-de-Daniel-partition.pdf
On les appelle Répons (responsorii) car, étant plus difficiles à chanter que les psaumes et les hymnes, ils sont confiés à un petit groupe de moines, de moniales ou de chanoines. Placé au centre dans la nef, avec de chaque côté latéral le double choeur qui chante dans les stalles à tour de rôle chaque verset (antiphoné). Ce que font encore maintenant les anglicans.
Les orthodoxes ont gardé la tradition juive du chœur polyphonique invisible, dont les interventions rappellent les répons, appelés nocturnes selon les horaires de jour ou de nuit.
Pour la Semaine sainte, plus particulièrement pour le Triduum pascal, soit les jeudi, vendredi et samedi saints, la liturgie inclut les Lamentations de Jérémie reliées à l’alphabet hébreu. Cela nous donne pour chaque office 9 répons, dont plusieurs ont été plus inspirants que d’autres selon les compositions ultérieures, mais ils constituent tous des commentaires précieux à la Passion de Jésus.
Apport plus que majeur non seulement dans la liturgie mais également dans la musique, la peinture, le vitrail, la sculpture et bien sûr la mystique chrétiennes. La danse sacrée y apporte sa contribution contemporaine.
Sans oublier l’apport des chemins de croix, issus des Evangiles apocryphes, les Passions tellement nombreuses, les apports des innombrables cantates, les méditations et les sermons, depuis 2000 ans bientôt. Ce répertoire représenterait des milliers de km de rayons en bibliothèque s’il était possible de le rassembler !
Voici un résumé utile pour se repérer à la lecture d’un titre. On trouve facilement sur internet les textes complets et les traductions de ces Nocturnes.
Entre autres sources de réflexions, je vois dans la coupole du Panthéon romain, chef d’oeuvre d’architecture, une stimulation à nous laisser aspirer par la lumière, après notre vie terrestre si cloisonnée de nuit comme de jour, loin des disputes théologiques.